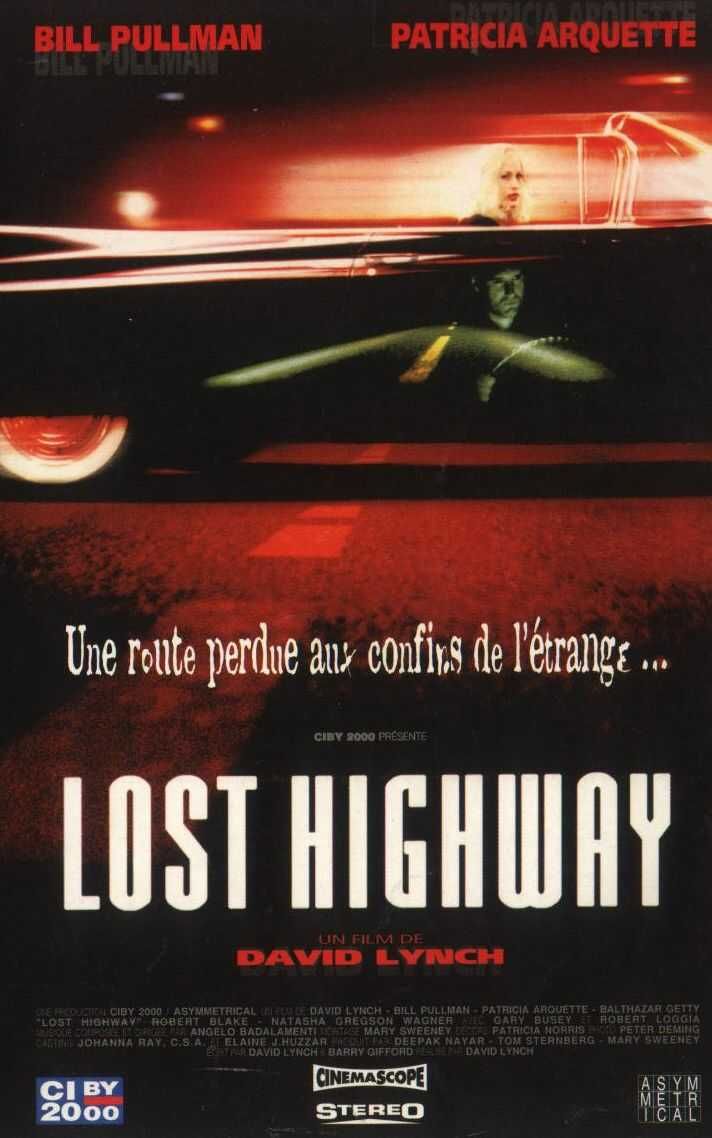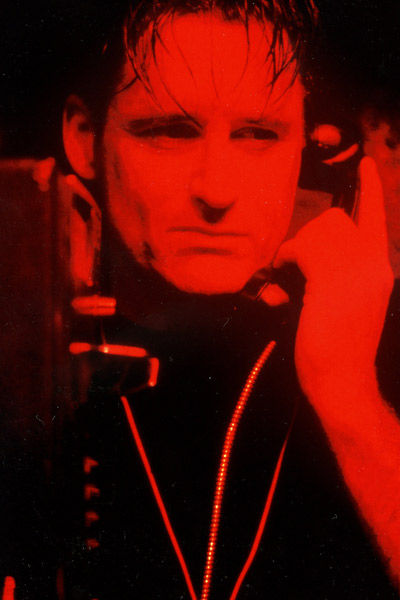|
LOST HIGHWAY
Fiche technique : |
L'histoire :
Fred Madison, saxophoniste, soupçonne sa femme, Renee, de le tromper. Il la tue et est condamné à la peine capitale. Le film raconte l'histoire de cet assassinat du point de vue des différentes personnalités de l'assassin lui-même.
Critique :
En quelques minutes [...début du film...], Lynch tisse une toile fascinante tirant vers l'abstrait comme ces tableaux d'Edward Hopper. Le mystère est dans les murs autant - peut-être plus - que dans les visages "neutralisés" de Bill Pullman et de Patricia Arquette. On est au bord du vide, retenus par cette vibration du "bizarre dans le qui=otidien" que le cinéaste maîtrise comme jamais, qu'il étire jusqu'à l'épure et jusqu'au malaise. Puis la machine s'emballe à coups d'images chocs aussitôt effacées, sur fond de rock hardcore. Comme si le cinéaste, en se copiant lui-même (cette seconde partie fait penser à un remake nocturne et confus de Sailor et Lula), avait lui-même sabordé un grand film en puissance.
François GORIN (Télérama)
"J’ai des sentiments mitigés sur le travail de David Lynch. J’ai l’impression que son cinéma n’a pas de sens. Je n’aime pas cette idée d’expérimenter gratuitement. Cela ne suffit pas de choquer pour le plaisir de choquer. Mes scènes ont un but. J’essaie d’amener le public quelque part." Critique un peu sévère de la part du réalisateur de Brazil, Terry Gilliam.
Dans Lost highway, il est vrai que David Lynch ne cherche pas à amener son spectateur quelque part. Il le laisse libre de s’égarer où il veut. Comme un tableau, Lost highway donne la place à l’imagination... Incompréhensible certes, mais fascinant.
A travers l’histoire de Fred, un saxophoniste torturé par la jalousie, qui tue (ou croit tuer) sa femme, Lynch nous transporte dans un univers étrange entre schizophrénie et rêve. Scène après scène, Lynch nous perd volontairement dans les méandres de l’inconscient de son personnage central. Toutes les scènes à caractère explicatif ont été volontairement coupées afin de "laisser la fenêtre ouverte pour que le rêve continue".
David Lynch aime filmer l’esprit humain, et pour la première fois dans Lost highway, il pose sa caméra à l’intérieur du cerveau de Fred Madison. L’univers mental d’une personne est infiniment complexe, surtout quand cet univers frise la pathologie, et tout au long du film le spectateur se trouve plongé dans les pensées irrationnelles et déstructurées du héros.
Le scénario de Lost highway (autoroute perdue) s’est construit autour du titre. David Lynch a trouvé cette expression dans un livre de Barry Gifford (le co-scénariste de Lost highway). Ces mots, empreints de mystère, ont suscité le reste. Lynch a eu l’idée de la première partie du film (quand le couple Bill Pullman et Patricia Arquette trouve d’inquiétantes vidéos de leur maison et de leur intimité sur le seuil) le dernier jour du tournage de Fire walk with me. David Lynch refuse d’expliquer plus son film. Il considère que de nombreux indices sont donnés et que les possibilités de compréhension sont infinies. Comme dans la vie, dans Lost highway, on ne sait jamais ce qui va arriver...
On retrouve dans ce film des allusions à celui que Lynch considère comme "le maître", Alfred Hitchock. En effet, comment ne pas penser à Vertigo et à la transformation de Kim Novak devant une Patricia Arquette brune et réservée dans la première partie et son double blonde platine et fatale par la suite ?
Quant à la performance des acteurs et en particulier de Bill Pullman, elle est quasi parfaite. Pullman par les seules expressions de son visage laisse deviner les pensées intérieures déjantées de son personnage.
Poétique et violent, esthétiquement parfait et musicalement envoûtant, Lost Highway se regarde sans compter, scène par scène ou d’une traite en fonction du rêve dans lequel on a envie de se plonger.
Laurence MOREL (A Voir, A lire)
Co-écrit avec Barry Gifford, "Lost Highway" est une œuvre terriblement angoissée, paranoïaque, noire et mystérieuse composée d’une trame principale qui se dédouble, à l’image de personnages très vite précipités dans l’absurde et l’irréel. L’un des points de départ provient de l’envie de David Lynch de constituer un récit libre à quatre mains, préservant mordicus le champ de la multiplicité des interprétations possibles face aux événements des l'histoire grâce notamment à la permanence de zones d’ombres. Cet aspect est plus que jamais présent et abouti dans "Lost Highway", décliné sous toutes ses formes comme le générique de début et de fin du film, un bout d’autoroute semi visible qui plonge à toute vitesse le spectateur dans le noir. Cette méthode suggestive est l’une des clés fondamentales du film et de, manière plus générale, la promesse de la bonne réception du cinéaste Lynch globalement. "Lost Highway" est ainsi dans le genre, un des meilleurs exemple d'approche de la peur filmée au cinéma, le film étant basé sur un système de plans et des scènes qui amorcent toujours en cachant ou parasitant certaines informations pour forçer le spectateur à prolonger lui-même, mentalement, des lignes de fuites dirigées vers l’obscur. Avec tous les instruments cinématographiques en sa possession, Lynch agit ainsi. Inspiré en amont par les symptômes d’une maladie rare mais bien réelle, la « fugue psychogénique » procurant de "merveilleuses sensations" (dixit Lynch !) à savoir une perte d’équilibre constante chez des sujets déjà malades, (on notera que le sujet "déviant" est bien ce qui intéresse en priorité Lynch), le réalisateur se lance dans une transposition sensitive et au fond très risquée pour l’écran. Lynch sous tend en parallèle une réflexion assez sourde sur la dimension réelle et irréelle des souvenirs de l’homme et la capacité de son esprit à refouler certains éléments qui sont produits. Ainsi les différents « court-circuitages » scénaristiques et figuratifs du film - Fred qui se transforme en un autre, les « deux » Patricia Arquette, "l’homme mystère", etc…- permettent de désarçonner le public à la façon d’un grand saut dans le vide. Beaucoup de scènes du film restent en ce sens absolument mémorables, souvent emblématiques de cette poésie noire et intrigante que développe Lynch avec une tension toujours contenue: Fred assistant à son meurtre dans une vidéo, Fred pénétrant dans l’un des murs du couloirs de son appartement, Fred au lit se retournant vers sa femme Renée qui présente le visage d’un vieil homme, etc… Comme toujours, Lynch s’aide beaucoup du son pour habiller son univers. Dans "Lost Highway" un fil sonore ambiant très angoissant est présent tout au long du film, la musique, les voix d’Elisabeth Frazer, de Bowie, de Rammstein sont exploitées et manipulées avec dextérité, intelligence à chaque moment opportun. Défiant ainsi toute forme d’analyse sur le plan du récit (combien au sortir de ce film se sont escrimés à vouloir en faire le tour!) David Lynch avec "Lost Highway" gravit un échelon supplémentaire dans la constitution d’un champ lexical cinématographique totalement personnel, sensible et voué à l’imaginaire le plus effrayant.
Olivier BOMBARDA (Arte)
Film noir schizophrénique, divagation cauchemardesque sur le thème éternel de la femme fatale, Lost highway, bercé par les mélopées grinçantes de la bande à Trent Reznor, est une œuvre fracturée et spasmodique qui, malgré sa relative opacité, nous capture et ne nous lâche plus jusqu'à la fin. Le début du film, très lent, très dépouillé et très angoissant, est peut-être ce que le cinéaste a fait de plus beau. On pourra consulter avec profit le scénario original (édité par les Cahiers du cinéma) pour constater à quel point le film, qui joue sur une succession d'ellipses fulgurantes, lui est supérieur. Il est surprenant de voir à quel point Lynch a su renouveler et enrichir son style expressif sans changer un iota à ses obsessions habituelles.
Vincent OSTRIA (Les Inrocks.com)
Mais si Lynch reprend les figures de ses films ou de quelques grands classiques et se réapproprie les emblèmes signalétiques de la culture américaine, c'est pour mieux les embarquer vers les nouveaux rivages de l'inconscient, vers un cinéma inédit où le temps et l'espace n'en finissent plus de se trouer et de se dédoubler.
Lynch reprend la route. Sept ans après Sailor & Lula, il semble renouer dès le générique avec la mythologie des bandes jaunes et des phares dans la nuit. Mais si Sailor & Lula était en partie un road-movie inspiré d'un road-novel de Barry Gifford , dans lequel les amants tentaient de rejoindre la Californie en passant par la Nouvelle-Orléans pour finalement s'arrêter dans une absurde bourgade texane, Lost highway est un voyage purement mental, à travers le temps et l'espace, dans une nuit américaine sans limites.
Profondément déconcertant c'est le moins que l'on puisse dire , utilisant toutes les conventions et tous les clichés du film noir pour mieux s'en débarrasser en chemin, les yeux d'abord rivés sur le grand catalogue à icônes afin de renouveler radicalement notre perception de spectateur, usant de tous les sortilèges plastiques dont le cinéma est capable, Lost highway nous entraîne vers des rivages inconnus, où nos repères et nos habitudes s'effacent au profit d'une étrangeté aussi belle qu'inquiétante. Certains de ne pas tout comprendre, loin de là, progressant à tâtons à l'intérieur d'un film qui se dérobe toujours, échafaudant des thèses forcément insuffisantes et lacunaires, nous sommes les captifs émerveillés du film le plus fascinant qu'il nous ait été donné de voir depuis des lustres.
La peur, la peur panique devant l'horreur de l'amour mort est le premier sentiment qui saisit le spectateur de Lost highway. Dans la maison au décor minimaliste comme si tous les vestiges d'une histoire commune avaient été peu à peu évacués pour mettre à nu l'os d'une désespérance ultime , le silence règne en maître, un silence assourdissant, de ceux qui contiennent l'envie de hurler sa souffrance. Le couple désuni se réduit à deux corps partageant un même espace de non-vie, un no man's land glacé où ils s'évitent, se frôlent parfois sans jamais plus se rencontrer. Pourtant, la femme (Patricia Arquette, de mieux en mieux) est belle, l'homme (Bill Pullman, bien mieux que dans Independence Day) aussi. Avant, dans un passé proche, ces deux-là se sont aimés follement, ces choses se devinent. Mais la passion a laissé place à l'hébétude, à la tristesse de s'apercevoir que les cendres sont froides et que plus rien ne pourra les ranimer. A cet univers clos sur le malheur répondent les bruyants échos du club de jazz, où Fred exerce ses talents de sax ténor. C'est là qu'il a rencontré Renee, alors accompagnée d'un moustachu à l'air peu engageant. D'abord spectatrice enthousiaste de ses performances, Renee évite maintenant de venir l'écouter. Elle préfère rester à la maison. Pour lire, prétend-elle. "Read what, Renee ", interroge Fred. Le silence qui lui répond vaut tous les aveux. L'agonie est proche, elle sera stupéfiante.
Cinéaste romantique, croyant en la diversité des mondes et en la force de l'Amour comme en la présence constante du Mal, Lynch a toujours oscillé entre la face lumineuse (l'amour de Sailor & Lula, au-delà des années, de la prison et des péripéties de leur liaison) et la face sombre (la ville de Twin Peaks, entièrement gangrenée par le flux incontrôlable des pulsions).
Jusqu'au Bob/Leland Palmer de Twin Peaks, figure paternelle possédée par les forces du Mal, ses personnages masculins appartenaient assez clairement à l'un ou à l'autre monde. Ainsi, le Jeffrey de Blue velvet ou le James de Twin Peaks restaient jusqu'au bout de braves garçons, malgré leur attirance sexuelle "malsaine" pour des filles flambées. En revanche, les femmes lynchiennes (l'innocente et caricaturale Sandy de Blue velvet mise à part) sont les représentantes désignées de ce basculement de la lumière aux ténèbres. Ambivalentes, constamment doubles, à la fois mère dévouée et esclave sexuelle (Dorothy Vallens de Blue velvet), adolescente modèle et traînée (Laura Palmer), elles ne cessent de se métamorphoser. De ce point de vue, Lost highway marque un tournant : Lynch semble avoir glissé du côté du "monde noir", laissant l'arc-en-ciel du Magicien d'Oz loin derrière lui. Si le couple ne peut plus être que le premier cercle de l'enfer, le héros lynchien va à son tour subir l'épreuve du dédoublement. Mais cette fois-ci, pour la femme comme pour l'homme, les deux faces resteront uniformément noires, sans le moindre espoir de retour ni de guérison. La lumière ne pénètre plus l'univers de David Lynch.
L'inéluctable dégradation des rapports amoureux entraîne à la fois une hideuse mue nocturne (celle du visage de Renee), le désir de meurtre comme palliatif au sexe défunt et le besoin d'interroger le passé la source maudite qui a infesté l'amour et annihilé toute possibilité de futur. Pour son plus grand malheur, le nouveau héros lynchien est doté de mémoire. Il part donc à la chasse aux mauvais souvenirs. De l'extérieur arrive une série d'indices en forme de cassettes vidéo qui montrent d'abord les abords de la maison, puis le couple endormi. Et, par le biais d'images sales et menaçantes, ils contemplent médusés l'épouvantable spectacle de leur déroute. Lors d'une fête, Fred rencontre un curieux personnage à la face blanchâtre qui, à mots couverts, lui révèle les possibilités infinies du basculement dans la relativité du temps et de l'espace. Jamais nommé dans le film, il est désigné sous l'appellation de "Mistery Man". Passeur vers les territoires parallèles, il pourrait tout aussi bien répondre au surnom de "Mister Memory", comme le phénomène de foire des 39 marches, ou à celui de "Mister Cinema", maître démiurgique de l'image et du son. A force de sonder les murs et d'arpenter les couloirs de la maison, Fred finit par trouver (créer ?) un sas qui lui donne accès (au sens d'accès de fièvre) à l'ancienne Renee, une faille spatio-temporelle vers la vie passée de sa mal-aimée, un trou noir qui épouse vaguement mais très logiquement la forme d'un pubis brun. Revenu de l'autre côté du miroir, il ne peut que constater les dégâts en animant l'écran noir de la télévision. Il a massacré sa femme.
Alors commence un second film, aussi luxuriant et bariolé que le premier était clinique et monochrome, mais tout aussi étouffant. Chez Lynch, l'emploi des objets symboles d'une imagerie figée est propice à tous les déclenchements narratifs. Ils sont autant de leurres, d'autant plus efficaces qu'immédiatement reconnaissables, pour égarer le spectateur dans un univers subtilement transgressé. Comme son personnage masculin, Lynch remonte aux sources du film noir afin de faire affleurer les racines du mal. Donc, après le grand retour du refoulé seventies qu'incarnait Bob le hippie-killer de Twin Peaks , le cinéaste s'est emparé des défroques et des vestiges fifties. Dans une banlieue lambda, aussi vide et terne que celle de Blue velvet, avec les mêmes jardins tranquilles et les mêmes barrières de bois blanc, Fred a accouché de Pete, son double juvénile, un cliché ambulant tout droit sorti de La Fureur de vivre (hypothèse haute et noble) ou du feuilleton Happy days (hypothèse basse et vulgarisée). Sorti de ses entrailles, accouché dans une explosion de chair vive, littéralement chié par un sphincter sanglant, Pete porte tous les attributs du teenager à l'ancienne. Minable petit voleur de voitures, motard rescapé de L'Equipée sauvage, clone délayé de James Dean, fils ahuri de parents encore plus ados que lui (Ray Ban, baskets, jeans : la panoplie complète), mécano dans un garage tenu par l'ineffable Richard Pryor et amant d'une quelconque girl next door (interprétée, comble de la perversité lynchienne, par la propre fille de Natalie Wood, l'inoubliable Judy du film de Ray), le pauvre Pete devra résoudre une équation insoluble et affronter la femme fatale, le démon de toujours.
En effet, Renee la brune glaciale s'est métamorphosée en Alice la blonde explosive. Cheveux platine, lèvres peintes et humides, apparaissant pour la première fois dans une Cadillac noire, elle aussi est une icône mouvante prélevée dans le réservoir des mythes éternels. Synthèse sur-signifiée de toutes les garces de tous les films, elle est synonyme des chromos les plus extravagants, des couchers de soleil les plus sulpiciens et des machinations les plus tordues. Surtout, elle incarne le sexe à elle toute seule. Qu'elle soit une victime souillée par des brutes sadiques ou une fervente masochiste accrochée à ses tourments, chair contrainte de films pornographiques ou spectatrice/actrice enthousiaste de snuff movies, cette ambiguïté même demeure insupportable. Pour reprendre une thèse chère à notre confrère Jean-François Rauger, l'insondable mystère de la jouissance féminine reste le plus cruel des supplices pour l'homme confronté simultanément au sexe/spectacle le film super 8 qui ne cesse de défiler durant le meurtre et à la carnation blafarde du corps présent. Parti à la poursuite de la connaissance, nouveau Faust en mal de complétude, Fred/Pete voit sa quête se transformer en cauchemar. S'il parvient à gommer la part d'ombre dans le passé de Renee/Alice, si la destruction momentanée du Mal (Mr Eddy/Dick Laurent) rend un peu d'unité à un monde fragmenté et fait disparaître la femme blonde de la photographie, le film revient à son point de départ et reprend son mouvement perpétuel en forme de boucle sans fin celui d'une pensée toujours insatisfaite car vivante, d'une conscience malheureuse pour qui l'oubli n'existe pas.
En se glissant dans les pas de son héros, en opérant une remontée vers la formation des clichés trop encombrants et des images devenues des enluminures obligées, David Lynch fait oeuvre d'iconoclaste inspiré qui sait qu'il faut faire semblant de se couler dans le moule pour mieux le faire exploser. Si En quatrième vitesse, Les Tueurs ou Traquenard remontent parfois à la surface comme des bouffées de chaleur , ils sont aussitôt digérés puis évacués. Carburant nécessaire à la poursuite du mouvement, ces films deviennent vite des déjections gazeuses qui se dissolvent dans l'atmosphère. Réflexion sur un cinéma d'aventurier qui puise sans cesse dans le stock afin d'opérer une percée plutôt que de se contenter de faire du surplace , Lost highway fonce vers les nouvelles rives de l'inconscient. A toute allure.
Frédéric BONNAUD (Les Inrocks.com)
Découvrez d'autres sites sur Lost Highway :
Ciné-Club de Caen
Wikipedia
Film de Culte
Vadeker Club
CinEtudes
Cadrage.net
Objectif Cinéma
Ecran Noir
Cahiers du Cinéma
Horreur.com
Erudit.org
www.davidlynch.de
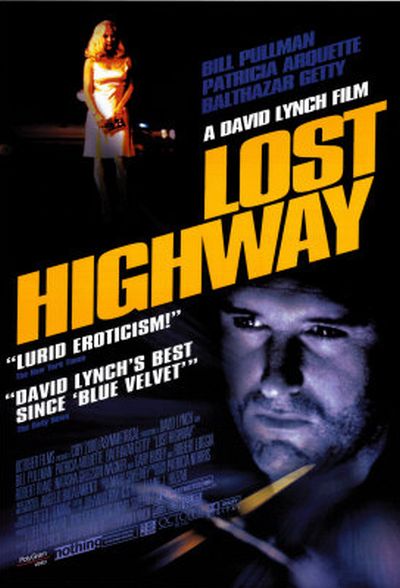
| |